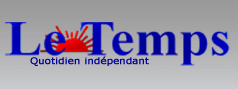/images/Indrawati_1.jpg) Sur la photo de groupe des ministres des finances du G20, le 14 mars, impossible de la rater : elles ne sont que deux femmes. Côté monde développé, Christine Lagarde, la Française, se distingue par la tache claire de ses jambes, au milieu d’une rangée de pantalons sombres. Côté monde émergent, l’Indonésienne a beau s’être habillée en homme, elle, c’est sa tête, jeune et féminine, qui se détache des crânes dégarnis.
Sur la photo de groupe des ministres des finances du G20, le 14 mars, impossible de la rater : elles ne sont que deux femmes. Côté monde développé, Christine Lagarde, la Française, se distingue par la tache claire de ses jambes, au milieu d’une rangée de pantalons sombres. Côté monde émergent, l’Indonésienne a beau s’être habillée en homme, elle, c’est sa tête, jeune et féminine, qui se détache des crânes dégarnis.
Chez elle, à Djakarta, Sri Mulyani Indrawati ne s’habille pas en homme. D’abord parce que, pour économiser l’énergie, elle a fait monter la température de l’air conditionné dans les bureaux, et dehors comme dedans, on est nettement mieux en robe, jambes nues. Parce que, ensuite, la crise économique mondiale a donné naissance ici à une campagne « Achetez indonésien », pour favoriser la relance de l’économie par la demande intérieure.
Alors, celle qui cumule deux portefeuilles-clés du gouvernement – ministre des finances et coordinatrice de la politique économique – ne peut pas faire moins que de donner l’exemple. Et cet après-midi, à la fin de notre entretien au ministère de l’économie, dans un bureau sans âme au mobilier imposant, elle vante sans vergogne ses escarpins vernis crème made in Indonesia, qui complètent une robe en batik bleu vif et blanc, touche de gaieté bienvenue sous l’éclairage au néon.
Avec sa collègue et grande complice Mari Pangestu, ministre du commerce, titulaire comme elle d’un doctorat d’économie d’une université américaine, elles font assaut d’élégance locale, l’une en soie l’autre en imprimé batik. Ne pas en déduire que c’est un gouvernement de femmes : « On est 4 sur 34, moins qu’en Afrique du Sud », relève la ministre des finances.
A 46 ans, Sri Mulyani Indrawati, « Ani » pour les Indonésiens, est l’arme secrète de cette démocratie dynamique et brouillonne, foyer de catastrophes naturelles et désastres en tout genre. Dans un pays dont 85 % des 240 millions d’habitants sont musulmans, femme moderne au pouvoir, la tête nue, elle incarne l’islam ouvert. Aux commandes d’une économie émergente dont la crise mondiale vient ralentir la courbe de croissance prometteuse, elle est la caution des bailleurs de fonds internationaux, qui apprécient son sérieux et sa compétence.
Ministre technique, sans étiquette politique, elle a lancé dès son arrivée au ministère des finances, en 2005, une offensive implacable contre la corruption généralisée dans les administrations des douanes et des impôts, qui lui a mis à dos quelques barons, mais a assuré sa popularité parmi les Indonésiens. Dans son dernier classement des « 100 femmes les plus puissantes du monde », le magazine américain Forbes a placé Sri Mulyani en 23e position. Et à la veille d’élections législatives, le 9 avril, qui seront suivies d’un scrutin présidentiel le 8 juillet, son nom circule comme possible vice-présidente si le président sortant, Susilo Bambang Yudhoyono, « SBY » – que les sondages donnent favori pour un deuxième mandat – décide de changer de coéquipier.
Elle s’en esclaffe, bien sûr, et assure vertueusement avoir pour seule ambition de mener à bien sa tâche actuelle, compliquée par une crise qui ne l’a pas surprise. Les déséquilibres économiques mondiaux, « ça fait cinq, dix ans qu’on en parle » dans les forums internationaux, dit-elle, « qu’on regarde ce modèle de croissance qui n’est pas durable, qu’on discute et que rien ne se passe. Et puis, un jour, la bulle éclate et il faut avaler les conséquences ». La faute aux Etats-Unis ? « Non ! La mondialisation, la technologie, on voulait tous en être… Quand ça marche, tout le monde est content ! »
Sri Mulyani Indrawati vice-présidente ? Vieux routier de la politique indonésienne, Jusuf Wanandi en doute : « Oui, elle est dure et compétente, mais elle n’est pas politicienne. Presque trop dure pour l’Indonésie : c’est le seul homme du gouvernement ! » Elle-même, pourtant, ne dédaigne pas la politique : « Chaque choix budgétaire est politique », justifie-t-elle. « C’est une praticienne plus qu’une théoricienne, dit l’un de ses proches conseillers, l’économiste Chatib Basri. Elle comprend vite, elle est réactive et elle a du courage. Depuis le début, c’est sa force. »
C’est ainsi qu’elle a remplacé, d’un grand coup de balai, 1 300 fonctionnaires des douanes par 800 autres, mieux payés. Puis reconnu un échec, tout en maintenant son offensive quand, six mois plus tard, un raid de la commission de lutte contre la corruption dans les bureaux des douanes du port de Djakarta a permis de saisir 50 000 dollars enfouis dans les tiroirs et les armoires de ces nouveaux fonctionnaires. Plus récemment, elle aurait offert sa démission lorsqu’un conflit l’a opposée à un autre ministre, l’un des hommes les plus riches du pays, qui semblait confondre intérêt public et intérêt privé. Interrogée, elle ne confirme ni ne dément l’épisode. « Disons que je n’ai jamais violé mes principes d’intégrité, répond-elle avec un sourire entendu. Parce que, pour moi, parvenir à instaurer la confiance de la société dans l’Etat est devenu une obsession. C’est le but le plus important que je me suis fixé. »
D’où lui vient cette obsession ? De son expérience au FMI, où ses collègues, « y compris le Français », n’ont cessé de lui faire la leçon : « Mais regardez donc ce qui se passe dans votre pays ! » Des valeurs, aussi, que lui ont léguées ses parents, tous deux professeurs. De l’islam, enfin, « dont le nom lui-même évoque la justice, et qui dit justice dit intégrité ». Car Sri Mulyani est tout ça à la fois : « Musulmane, indonésienne, javanaise, formée aux Etats-Unis. » Fille d’intellectuels de Java, brillante étudiante à l’université d’Indonésie, repérée par le chef d’un groupe d’économistes libéraux qui l’envoie faire un doctorat à l’université de l’Illinois, elle revient en 1992 pour, à son tour, diriger un institut de recherche économique, dont le travail portera ses fruits à la chute de Suharto, en 1998.
Brièvement conseillère du président Abdurrahman Wahid, elle part aux Etats-Unis en 2001 d’abord pour enseigner, puis comme directrice exécutive au FMI, où elle représente 11 pays d’Asie-Pacifique. C’est là que « SBY », élu président en octobre 2004, vient la chercher pour la faire entrer dans son gouvernement.
A Washington, ses trois enfants allaient à l’école américaine : au retour, elle les met à la prestigieuse école islamique Al-Azhar. Elle participe aux réunions de parents d’élèves et protège jalousement sa vie de famille. « Hier soir, j’ai dormi avec mon plus jeune fils (11 ans) parce que je lui manquais. » Son mari, banquier, a quitté la finance depuis qu’elle est ministre : elle ne voulait pas de conflit d’intérêts. « C’est un gros sacrifice de sa part, admet-elle, on en a discuté, et je lui ai dit : quoi que tu fasses, on soupçonnera que tu profites de ma position. » Toujours son obsession. Alors, le mari d’Ani sans peur et sans reproche se consacre à la philanthropie.
 Islam-pluriel Contre l'islamisme et les traditionalismes
Islam-pluriel Contre l'islamisme et les traditionalismes