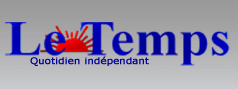Dans cette nouvelle extraite de son dernier recueil, l’écrivain égyptien Abdel-Aal Al-Hamamsi explore un thème classique, celui de la réconciliation nationale entre chrétiens et musulmans. Avec une note de nostalgie romantique.
Dans l’enceinte de la mosquée Al-Omari, là où se rassemblent les gens pour se saluer après la prière du vendredi, se tenait un petit garçon, debout à côté de son père, arborant fièrement son nouveau cafetan en soie et son bonnet brodé de motifs jaunes lumineux. Le bras gauche de l’homme, imposant dans son habit noir, reposait sur l’épaule du petit dont la tête atteignait à peine l’aisselle du père. Le bras droit était tendu, avenant, pour saluer les fidèles qui se pressaient vers lui. Le mot « haraman » était sur toutes les lèvres. Le prêtre Ibrahim arriva, de retour du grand marché, avec une pastèque dans les mains. Quand il fut à leur hauteur, il fit habilement passer la pastèque dans sa main gauche, mais Hag Mahran la lui prit et la tendit à son jeune fils réfugié dans son ombre, lui ordonnant de l’apporter à la maison de père Ibrahim. L’homme voulut refuser, par pitié pour le garçon tout maigre. Mais l’enfant ne se laissa pas faire et s’éloigna de lui, tandis que son père s’adressait au prêtre, qui était aussi son voisin : « Ne t’inquiète pas. Il court plus vite qu’un cheval. Ce n’est plus un enfant, il a plus de huit ans. Il connaît maintenant le Coran en entier par cÅ“ur et il y a deux jours, il l’a récité au cheikh Al-Guibali. Sa récitation était aussi fluide qu’un courant d’eau. Maintenant, il s’apprête à apprendre la Borda de l’Imam Al-Boussayri ». Tandis que le père parlait, le garçon, tout fier, s’approcha à nouveau. Le prêtre Ibrahim entra sa main dans son vêtement de corps, sous sa cape aux manches amples, en sortit des pièces de vingt piastres à l’effigie des rois Farouq et Fouad et les glissa dans la poche supérieure du cafetan du petit garçon. C’était une façon de le récompenser pour avoir déjà appris le Coran par cÅ“ur à un si jeune âge. (…)
Avant que le père Ibrahim ne parte, le cheikh dit au garçon : Si tu veux, tu peux ne pas rentrer à la maison tout de suite, mais dis à ta mère que je vais déjeuner avec les hommes dans le champ d’Al-Mounchar. Si quelqu’un me demande, je serai de retour au coucher du soleil. Le père était au courant de son secret et savait très bien qu’il n’avait pas envie de l’accompagner (…). Il lui pinça gentiment l’oreille et partit avec les hommes.
Le garçon, pressé, précédait le père Ibrahim. Ce dernier s’arrêtait pour saluer les gens, échanger quelques mots avec certains. Dès qu’il passa la porte, dépassant l’entrée dont les canapés étaient tendus de klims en laine, il se retrouva dans la cour intérieure de la maison. Là , il y avait le four, les vases de farine, les jarres de fromage et les bidons de provisions. Il posa la pastèque sur le support des jarres d’eau, sans déranger une poule qui se mit à picorer son écorce. Il balaya le lieu du regard. Devant le pot de pâte, sa mère aidait la femme du père Ibrahim à cuire les hosties, pour le dimanche prochain, avec la farine de blé mêlé d’orge, qu’elle passait ensuite à Teghyana, la vieille domestique. La femme du prêtre était occupée à entretenir le feu dans le four, dont elle alimentait l’ouverture avec des bottes de fourrage, des tiges de fève et du bois de coton. Le garçon transmit à sa mère ce que lui avait dit son père. Il leva les yeux, mais ne vit pas trace de la petite fille, ni n’entendit sa voix. La vieille Teghyana comprit à quoi il pensait et voulut le rassurer : « Sabaha n’est pas là -haut. Elle est à l’église, elle aide Chafiq le diacre et son assistant Abadir à nettoyer l’autel et les icônes ».
Avant même qu’elle n’eut fini de parler, il avait déjà le bas de son cafetan entre les dents et était parti en courant. Teghyana éclata de rire, tandis que le sourire de la mère semblait faire écho à celui d’Oum Barsoum, la femme du prêtre, avec tout ce qu’il insinuait. Tout le monde connaissait les liens étroits de familiarité entre les deux enfants. Ils étaient inséparables, comme des jumeaux. Depuis que Sabaha était arrivée l’année précédente, ils s’étaient rapidement rapprochés. (…) Ils jouaient ensemble, lisaient les histoires illustrées. Elle faisait toujours partie de son équipe dans les jeux des enfants du quartier. Quand il lisait le Coran, elle était à ses côtés, lui répétant parfois ce qu’elle avait lu dans le Nouveau Testament. (…) Tout le monde savait qu’il était le fils du cheikh Mahran, une famille qui avait un important statut religieux, et comptait plusieurs cheikhs d’Al-Azhar et spécialistes de la charia. Personne n’y voyait rien à redire. Les maisons étaient voisines ; l’une arborait le croissant, l’autre la croix. L’échoppe du chrétien était contiguë à celle du musulman, leurs champs se jouxtaient, leurs enfants jouaient ensemble, les femmes étaient les mères de tous. Les minarets des mosquées enlaçaient presque les cloches des églises ; les chrétiens du village baisaient les mains des cheikhs et des imams, et les musulmans appelaient de bon cÅ“ur « Mon père » tous ses prêtres.
Il s’était arrêté devant l’entrée de l’église Sainte Demyana, tentant de retrouver son souffle après une course échevelée. Rachel, la fille de Teghyana, l’avait rattrapé. Elle lui donna un paquet dans lequel il y avait plusieurs galettes de pain, du fromage de chèvre et des œufs grillés sur la plaque du four : « Prends, c’est pour ton déjeuner, toi et Sabbouha. N’oubliez pas Chafiq le diacre et Abadir son assistant. C’est ce que te dit ta tante Oum Barsoum ».
Elle était à l’intérieur, un bout de velours noir à la main. Elle avait fini d’essuyer la poussière sur toutes les icônes. Avec son assistant Abadir, le diacre nettoyait les bancs et les murs. Une onde de joie l’envahit dès qu’elle le vit. Elle jeta le bout de velours et se précipita vers lui. Quand elle vit le paquet qu’il avait à la main, elle devina ce qu’il contenait. Elle garda leur part et laissa au diacre et à son assistant le reste. Elle prit Ahmad par la main et l’emmena vers le puits sous sycomore tout proche. C’était leur endroit préféré ; là , sous le tronc où étaient gravés leurs noms, l’un accompagné d’une croix, l’autre d’un croissant. Avant même d’entamer sa première bouchée, il entrevit une lueur de tristesse dans son regard. Il se dit qu’elle s’était à nouveau souvenue de sa mère, comme toujours. Il ne restait plus que deux jours avant la fête. Il était prêt à tout pour éteindre le désespoir dans son regard, pour voir ce rayon de joie qui y brillait quand elle était heureuse.
(…)
Elle lui tendit un œuf qu’elle venait d’éplucher ; la question lui échappa malgré lui : « Qu’est-ce que tu as, Sabbouha ? ».
La nouvelle le prit au dépourvu. Elle avait entendu son oncle, le prêtre Ibrahim, demander à son neveu, Attiya, d’aller à Assiout retirer un document pour y faire entrer la petite au Collège américain, en interne. Si elle avait eu le choix, elle n’aurait pas accepté. Mais elle ne pouvait pas s’opposer à la volonté de son oncle. C’était pour ça qu’elle était triste. (…)
Il posa l’œuf sur le grand mouchoir. Il sentit quelque chose lui pressurer le cœur. Quand elle vit les nuages de désespoir envahir son visage, tout son être, elle lui dit : « Tu seras toujours avec moi, Ahmad. Si j’avais eu un frère, il ne m’aurait pas été plus cher que toi ».
Il ne trouva rien à dire. Il était perdu. Assiout ! De longues années passeraient encore avant qu’il n’ait le droit d’entrer à l’Institut religieux Fouad 1er là -bas, malgré le fait qu’il connaissait maintenant le Coran en entier par cœur. Ils n’accepteraient pas un interne de huit ans. Sa mère le prédestinait à Al-Azhar, comme son oncle, président du tribunal religieux. Encore cinq ans avant de se retrouver là -bas, dans la même ville qu’elle.
Il repoussa sa main quand elle lui tendit un bout de pain mou. Elle secoua la tête, feignant le détachement et la gaieté. Elle lui disait : « Déride ton visage, Ahmad. Je ne vais pas en mourir. Je rentrerai pendant les vacances, et on rattrapera le temps perdu. On courra dans les champs, on lira des histoires, on jouera à cache-cache. On se disputera avec les enfants du Moallem Gabra, ces chenapans ».
(…)
« Tu n’es pas drôle aujourd’hui, Ahmad. Je te parle, et toi tu es absent, tu ne me réponds pas ! ».
Il savait, tout comme elle savait, que c’étaient là leurs journées. Mais le futur ne leur appartenait pas. Il deviendrait un homme, elle une femme, et quelqu’un viendrait l’emmener, peut-être même dans un village éloigné. Peut-être qu’il mourrait ou qu’elle mourrait sans qu’il ne la voie ou qu’elle ne le voie. Il espérait mourir immédiatement, pour que son visage soit le dernier qu’il ait vu et sa voix la dernière qu’il ait entendue. Un jour, il lui dit en lisant des versets du Coran qui promettent aux hommes pieux le paradis : « J’aurais aimé que tu m’accompagnes au paradis, Sabbouha, on serait servis par les houris ». Il s’abstint de lui raconter que le cheikh Al-Guibali lui avait dit que seuls entraient au paradis les musulmans qui avaient prononcé la double profession de foi. Elle lui répondit qu’elle aurait aimé qu’il l’accompagne au Royaume des cieux. Elle non plus, elle ne lui raconta pas qu’Abadir l’assistant lui avait dit que seuls ceux qui avaient été baptisés au nom du Christ et avaient la croix aussi profondément gravée dans leur cœur que dans le creux du poignet seraient admis au Royaume.
Il sentit qu’elle pensait à la même chose que lui. Il essaya de sourire, en prenant le bout de pain qu’elle lui tendait pour la deuxième fois. Il lui raconta qu’il avait lu dans un roman de poche, que lui avait amené son frère aîné Mahmoud, que « les âmes que Dieu a rapprochées sont destinées à se rencontrer, même si elles doivent affronter l’impossible ». Elle le regarda. Il comprit son regard. Ce n’était pas simplement l’impossible auquel ils faisaient face. Il tenta de mâcher la bouchée coincée dans sa bouche, en regardant le ciel au-dessus de lui. Elle regarda elle aussi le ciel. Chacun d’entre eux aurait aimé pouvoir s’adresser directement à Dieu, lui demander de les rassembler, sur terre, mais aussi au ciel. Malgré les larmes qu’ils avaient aux yeux, ils sourirent en même temps. Chacun d’eux connaissait bien le secret de l’autre. Un pigeon blanc descendit du sycomore et picora les miettes tombées entre eux. Ils se mirent à mâcher leur pain et le sel, avec un sentiment impérieux que Dieu les bénissait, qu’ils étaient Ses enfants. Sur terre, mais aussi dans tout Son Royaume.
Traduction de Dina Heshmat
Al Ahram hebdo (Egy) 15/05/07
 Islam-pluriel Contre l'islamisme et les traditionalismes
Islam-pluriel Contre l'islamisme et les traditionalismes