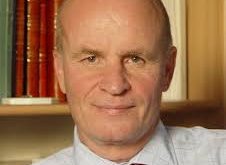Pour Olivier Roy, les religions qui ont du succès sont celles qui acceptent la déculturation et vivent sur le mythe d’un « pur religieux »![]()
La Croix : Dans La Sainte Ignorance (1), vous analysez le découplage de la religion et de la culture, qui caractérise, selon vous, l’évolution actuelle du religieux. Comment l’expliquez-vous ?
![]() Olivier Roy : Dans le phénomène religieux, il y a toujours une tension entre religion et culture. La transcendance, dans les grandes religions, s’exprime sous la forme d’une révélation, et donc d’une rupture avec la culture. En même temps, les grandes religions se sont toutes enculturées – ou « inculturées » si on utilise le vocabulaire de l’Église catholique : elles se sont identifiées à une culture qu’elles ont transformée. Le christianisme s’est moulé dans l’hellénisme, l’islam s’est identifié à l’identité arabe…
Olivier Roy : Dans le phénomène religieux, il y a toujours une tension entre religion et culture. La transcendance, dans les grandes religions, s’exprime sous la forme d’une révélation, et donc d’une rupture avec la culture. En même temps, les grandes religions se sont toutes enculturées – ou « inculturées » si on utilise le vocabulaire de l’Église catholique : elles se sont identifiées à une culture qu’elles ont transformée. Le christianisme s’est moulé dans l’hellénisme, l’islam s’est identifié à l’identité arabe…
Les allers et retours entre religion et culture ne sont donc pas nouveaux. Ce qui me frappe aujourd’hui, c’est que les religions qui ont du succès, celles qui convertissent, vont de paire avec un processus de déculturation. C’est le cas, par exemple, de l’évangélisme protestant ou du salafisme musulman. Nous connaissions la culture sans la religion – c’est la sécularisation –, nous sommes maintenant dans le temps de la religion sans la culture.![]()
Ce repli sur un « pur religieux » est-il une conséquence de la sécularisation ?
![]() La sécularisation a entraîné de manière plus ou moins rapide l’autonomie du champ culturel et du champ religieux. On le voit dans le cas de l’enseignement : à un moment donné, on expulse le religieux du savoir général et l’enseignement du religieux devient séparé du reste.
La sécularisation a entraîné de manière plus ou moins rapide l’autonomie du champ culturel et du champ religieux. On le voit dans le cas de l’enseignement : à un moment donné, on expulse le religieux du savoir général et l’enseignement du religieux devient séparé du reste.
Autrefois, les madrasas dans le sous-continent indien proposaient une éducation globable, comprenant l’ourdou, le persan, l’arabe, la littérature, la poésie, la cosmogonie et la médecine traditionnelle et, enfin, la religion. C’était la Sorbonne du Moyen Âge. Aujourd’hui, elles n’enseignent que le religieux, dans une concurrence des savoirs.
Pourtant, la sécularisation n’entraîne pas nécessairement l’exculturation du religieux. En France, croyants et laïques ont longtemps partagé une culture commune. La définition de la famille et les questions de mœurs faisaient l’objet d’un consensus. La situation a changé dans les années 60, lorsque le religieux a commencé à percevoir le culturel, non plus simplement comme profane, mais comme païen.![]()
Pour vous, cette mutation s’accompagne d’une standardisation du religieux…
![]() La standardisation du religieux n’est pas nouvelle. Par le passé, on a connu des formes de standardisation venues de la domination politique. Aujourd’hui, l’uniformisation du religieux a plusieurs origines, mais elle passe notamment par le marché.
La standardisation du religieux n’est pas nouvelle. Par le passé, on a connu des formes de standardisation venues de la domination politique. Aujourd’hui, l’uniformisation du religieux a plusieurs origines, mais elle passe notamment par le marché.
Tout comme les produits sont standardisés par et pour la consommation mondiale, les produits des religions sont standardisés. Les chaînes télévisées religieuses, les « god’s channels », en sont l’exemple le plus frappant. Elles proposent un produit calibré, où la langue est un vecteur de la parole de Dieu, mais plus du tout de la culture.
Chez les pentecôtistes, cette logique est poussée à l’extrême dans la glossolalie : la langue disparaît et on ne parle plus aucune langue. On assiste là à un processus extrême de la déculturation, non seulement du message, mais de son vecteur, la langue elle-même.![]()
Ce découplage avec la culture est-il viable pour les religions ?
![]() C’est toute la question. Elle se pose avec le défi de la transmission, car on ne transmet pas une rupture. Comment peut-on naître d’un born again ? Aux États-Unis, on voit bien que les convertis des années 70-80 peinent à transmettre quelque chose à la génération suivante…
C’est toute la question. Elle se pose avec le défi de la transmission, car on ne transmet pas une rupture. Comment peut-on naître d’un born again ? Aux États-Unis, on voit bien que les convertis des années 70-80 peinent à transmettre quelque chose à la génération suivante…
Le succès actuel des évangéliques ne signifie donc pas que l’évangélisme protestant va devenir la religion mondiale. Sur le court terme, le protestantisme évangélique profite de la déconnexion du culturel et du religieux, mais, sur le long terme, il est plus fragile.
De manière générale, les prêcheurs religieux cherchent aujourd’hui à reconnecter les marqueurs religieux à des marqueurs culturels, mais de manière artificielle. On le constate dans toutes les religions. En France, par exemple, on voit l’Église catholique organiser des soirées de rock chrétien, où le prêtre adopte un parler jeune…
Ici, on ne se reconnecte pas à une culture, on se raccroche à des sous-cultures, comme la sous-culture jeune. Cette reconnexion est accompagnée d’ambiguïtés profondes. On le constate aussi pour le retour au latin dans l’Église catholique. Pour les adeptes de cette liturgie, le latin ne fonctionne pas comme référence à la culture latine, mais comme quelque chose de magique.![]()
Mais y a-t-il encore une culture commune dans laquelle le religieux puisse s’inculturer ? Ou faut-il parler d’une crise de la culture ?
![]() Ces processus de déculturation se font en faveur d’un modèle culturel américain. Mais est-ce encore une culture ? C’est tout le débat. Pour ma part, je pense qu’il ne s’agit pas d’une culture au sens fort du terme. Il s’agit plutôt de codes de comportements, d’expression, de normes…
Ces processus de déculturation se font en faveur d’un modèle culturel américain. Mais est-ce encore une culture ? C’est tout le débat. Pour ma part, je pense qu’il ne s’agit pas d’une culture au sens fort du terme. Il s’agit plutôt de codes de comportements, d’expression, de normes…
Il existe bien sûr une culture américaine, mais ce n’est pas elle qui s’exporte au niveau mondial. Ce que l’on exporte, c’est un mode de communication. Le problème qui se pose va donc au-delà de l’américanisation et pose la question de la crise de la culture.![]()
Comment l’Église catholique réagit-elle à cette désarticulation ?
![]() La réaction actuelle est une espèce de tribalisme : on se retrouve entre soi, en cherchant éventuellement à faire venir quelques autres… L’Église catholique est, soit dans la nostalgie, soit dans le discours de l’extériorité : la culture est hostile, « matérialiste », « pornographique », « culture de mort » etc.
La réaction actuelle est une espèce de tribalisme : on se retrouve entre soi, en cherchant éventuellement à faire venir quelques autres… L’Église catholique est, soit dans la nostalgie, soit dans le discours de l’extériorité : la culture est hostile, « matérialiste », « pornographique », « culture de mort » etc.
Benoît XVI voudrait que la culture occidentale retrouve son esprit, son âme chrétienne. Le problème, c’est que la culture telle qu’il l’envisage – la culture classique occidentale, reposant sur la tradition philosophique grecque et latine – n’existe plus, ou presque plus. Et dans le tiers-monde, là où se trouvent les effectifs catholiques, elle est perçue comme occidentale…![]()
Vous étudiez « la sainte ignorance » et les fondamentalismes religieux, mais ne constate-t-on pas aussi l’émergence d’un fondamentalisme séculier et scientiste, un « naturalisme dur » dirait le philosophe Jürgen Habermas, qui lui aussi prospère sur la crise de la culture ?
![]() Absolument. Ce qui est très frappant en ce moment, c’est le retour du biologisme. Tout devient biologique : la violence, la différence homme-femme… On a une articulation très curieuse, schizophrène, entre une demande de liberté individuelle absolue et une pensée qui reste fondamentalement déterministe. De fait, la sécularisation ne profite pas de la déculturation du religieux. C’est ce que n’ont pas compris les laïques idéologiques à la française.
Absolument. Ce qui est très frappant en ce moment, c’est le retour du biologisme. Tout devient biologique : la violence, la différence homme-femme… On a une articulation très curieuse, schizophrène, entre une demande de liberté individuelle absolue et une pensée qui reste fondamentalement déterministe. De fait, la sécularisation ne profite pas de la déculturation du religieux. C’est ce que n’ont pas compris les laïques idéologiques à la française.
 Islam-pluriel Contre l'islamisme et les traditionalismes
Islam-pluriel Contre l'islamisme et les traditionalismes